La première chose que l’on retient lorsqu’on le (re)voit sur scène, c’est la profondeur de son regard. Ce dernier oscille entre sérénité et mélancolie et il ne laisse jamais indifférent. Il arrive à vous transpercer de sa douceur et s’illumine aussi d’une étincelle de joie et de vie, celle qui capte la lumière, celle qui vous attire inexorablement à sa rencontre. Comme si ce regard perdu ne cherchait que le soutien et l’amour de l’autre, modeste mais indispensable remède à une blessure personnelle, qu’il trainera comme un boulet 36 années durant.
Coiffure afro en avant tantôt hirsute, tantôt savamment apprêtée en boucles crépues, l’allure générale de cet Irlandais au teint métissé, hérité d’un père originaire de Guyana, ancienne Guyane Britannique située au nord de l’Amérique du Sud, véhicule un charisme à couper le souffle.
Fine moustache, boucle à l’oreille et taille altière, le jeune musicien consume sa jeunesse dans les nombreux excès connus de la scène rock, fuyant les affres de la perte d’un père disparu trop tôt. La détresse n’aura jamais été pour lui le signe d’un homme faible et sans défense mais plutôt une source d’inspiration, pour sa musique et les paroles qu’il couchera dessus avec son incroyable poésie des mots. Sur scène, la lumière l’entoure d’une aura qu’il parvient à cristalliser et les regards se portent sur lui tel un aimant attirant les vibrations du public. Celles qui lui donnent la force de continuer son œuvre, de gaver l’autre de sa musique soul et blues, parsemée de relents celtes, de nappes de beauté sonore. Une drogue bien plus douce à ajouter à la liste des nombreuses substances qu’il aura expérimentées.
Lorsqu’il joue de son instrument, il porte sa basse bien haut, bien calée, tout contre son cœur. On s’imagine à confondre les vrombissements de sa Fender avec les battements de son cœur. Le jeu est si limpide, si clair et si profond et il provient de si loin, du fin fond de ses entrailles, que l’on croit entendre son sang pompé par son muscle cardiaque venir claquer les cordes de sa basse. Un jeu de guitare pulsé par l’amour dont son cœur est gorgé, celui indéfectible pour ses fans. Une sorte de Lemmy ayant soudain troqué cuir et santiags pour des habits de crooner rehaussé d’une pointe de rock attitude plus raffiné.
Ici s’arrête la comparaison avec le divin bassiste de Mötörhead car sa voix est bien plus chaude et sensuelle. Elle susurre les paroles, elle s’immisce avec subtilité sur la mélodie, elle procure un regard conscient sur la réalité de la vie et des sentiments au travers d’histoires simples, de tranches de vie et de coups du sort. Un joyau de plus. Une pépite usée à l’épreuve des aléas de la vie et des expériences interdites en tous genres.
Philip Parris Lynott est un artiste hors pair. Une idole pour les uns, une icône en Irlande, un gars simple quoiqu’on en dise, une personnalité unique et transpirant de sensibilité par tous les pores de sa peau. Il est parti, lui aussi, si vite, trop tôt. Un matin de janvier 1986. Parti taper le bœuf avec Bon Scott et profiter de la compagnie de son père qu’il allait enfin pouvoir connaitre.
Alors que
Thin Lizzy continue son bonhomme de chemin et se taille un succès mérité, Phil Lynott se réserve une bulle de respiration personnelle en enregistrant durant l’hiver 1979 cet album solo, au Good
Earth studios de Londres dans le quartier de Soho ainsi qu’au Compass Point studio de Nassau aux Bahamas. Il se charge de la production du disque qui sortira chez
Vertigo en Europe et Warner aux US. Histoire de ne pas se sentir seul, même si le titre de l’album tend à prouver le contraire, il s’entoure de son comparse et ami, co-fondateur de Lizzy, Brian Downey à la batterie ainsi que de Scotty Gorham et Snowy White aux guitares. De nombreux invités seront aussi de la partie, dont
Gary Moore (RIP) et Mark Knopfler, mais aussi Huey Lewis à l’harmonica ou Jimmy Bain et Midge Ure, guitariste écossais plus connu comme le chanteur du groupe new-wave Ultra Vox, au piano ou synthétiseur.
Phil Lynott aborde un univers varié et à mille lieux de ce qu’il a pour habitude de produire avec son groupe habituel. Dès lors, il n’est plus question de performance ou d’objectif de ventes mais plutôt de liberté, celle de composer et jouer une musique qui lui parle, prendre du plaisir et en donner encore et encore. Les registres dans lesquels Phil se faufilent sont parfois déroutants pour un fan de
Thin Lizzy, mais au combien savoureux lorsque l’on s’attache à découvrir simplement l’artiste qui se cache derrière le gaillard au teint mat.
Imaginez Phil Lynott et Midge Ure ensemble, juste un instant. Si cela ne vous interpelle pas plus que ça, jetez une oreille sur « Yellow Pearl », pur morceau de techno rock, dont la mélodie de synthétiseur vous fera penser sans coup férir au lead repris par un certain Daniel Balavoine sur « Je ne suis pas un héros » quelques mois plus tard. Association contre-genre, presque mystique, vocoder et beat d’un autre monde que celui du hard-rock, mais pas une ride. Et aucune présence de guitare. Tout comme sur « Girls », mélodie pop mièvre et jouable en dormant, envahie de synthétiseurs, mais portée par une voix à la signature singulière. On entend bien sûr des guitares, mais presque étouffées, comme sur « Dear miss lonely hearts », à la construction plus classique. La batterie reste discrète alors que la basse tremble, sans doute sous l’effet des paroles douces et implorantes. Snowy administre un solo simple et aéré comme joué sur la pointe des pieds.
L’hommage à Elvis entonné sur «
King’s call » ressemble à une tranche de la vie d’équilibriste de Phil Lynott. Dans l’esprit Dire Straits mais pas dans une copie stupide, Mark Knopfler offre à son ami un blues-rock revisité et un solo aérien absolument sublime. La voix se promène avec grâce sur une mélodie éthérée qui résonne avec classe mais aussi qui raisonne l’individu désespéré par la perte d’une idole. Les cordes sont aussi présentes sur cet album. Intimiste, Phil Lynott a composé avec « A child’s lullaby » une magnifique déclaration d’amour pour sa fille et brise à nouveau une barrière en abordant le registre de la variété du dimanche après-midi, assez courante en ces années-là. Style improbable pour un père qui lève le voile sur un aspect touchant et intime de sa personnalité. A nouveau des cordes sur « Tattoo », dont on retiendra le groove de basse somptueux et le lead riff… d’harmonica d’Huey Lewis. Scott Gorham s’efface et reste en retrait comme fasciné par la fertilité de l’imagination et de l’association d’idées et de couleurs du bassiste et des autres artistes qui l’accompagnent.
D’autres expérimentations à nouveau sur cet album mais aussi quatre perles inoxydables et à l’éclat encore intact.
C’est sur une trame reggae-ska que «
Solo in Soho » vous cueille soudainement tandis que Jerome Rimson, bassiste émérite de jazz et de blues-rock, nous gratifie d’un travail tonitruant et vertigineux sur son instrument. Il sera l’un des rares « autorisés » à jouer de la basse sur un album de Phil Lynott. Les racines sud-américaines pointent le bout de leur nez sur une mélodie chaloupée et mélancolique, sublimée par la guitare de Snowy White. Que dire de la prestation de
Gary Moore sur « Jamaican rum ». Sur un rythme de rumba et de calypso, les deux Irlandais accrochent leurs notes dans une envolée délurée et délirante. Les steel drums décuplent l’ambiance afro des îles alors que les effluves de rhum titillent nos narines impatientes. Après une entame furtive à la
Kiss, l’harmonica de «
Ode to a black man » et l’énorme baffe administrée par la basse de Phil prennent possession du terrain. « If you see Stevie Wonder, tell him I hear » ou « If you see the doctor, tell him he’s king » rendent hommage aux illustres personnalités noires, comme Martin
Luther King, qui auront marqué l’Histoire au cours de la seconde moitié du vingtième siècle. Le titre gambade avec allégresse à l’image d’une chevauchée au milieu du
Far West et fait penser à une version moins tribale de « Sioux City Junction » par instant, si cela rappelle des souvenirs aux plus anciens d’entre nous.
Enfin, « Talk in ‘79 » vous cloue par son attaque de basse et son lead de slapping, soutenu par un Brian Downey visitant le kit complet de sa batterie. Titre pied-de-nez de jazz-rock teinté de funk sur lequel Phil Lynott décline ses paroles avant de le clôturer avec son pote derrière les futs d’un instrumental à deux voix tout en finesse et technicité.
Album à part d’un artiste de génie qui considère l’éclectisme comme une source de renouvellement sans pour autant renier ses origines. Le résultat peut paraitre inégal mais il confirme les multiples facettes d’un musicien troquant sa basse pour la guitare, les percussions ou le piano sans aucun problème.
Son image me revient à nouveau en tête.
Arc-bouté sur sa basse, son corps, comme absorbant les vibrations de l’instrument, se fige et se contorsionne, en complète harmonie avec la mélodie qu’il joue. Vassal et maitre de son outil de travail/plaisir qu’il fait conjuguer avec son organe vocal, chaleureux et envoutant. Oui, après l’avoir entendu au travers des sillons de ce disque à la touche si personnelle, je peux dire que je l’ai vu. Oui, je l’ai vu. L’homme qu’il est, inspiré et habité, gorgé d’influences diverses, rock et rasta, afro et celte, un creuset vivant, abordable et intouchable, à la fois complice et secret mais tout en sensibilité. Comme lorsque j’écoute les disques de
Thin Lizzy, ou lorsque je regarde les témoignages filmés de son incroyable talent. Oui ! Je l’ai vu. Icône païenne célébrant avec ses fidèles d’innombrables messes mêlant décibels et plaisir. Je pense pouvoir dire, j’ai vu Dieu !
You could always hear the
King’s call
Philip Parris Lynott (1949-1986) RIP
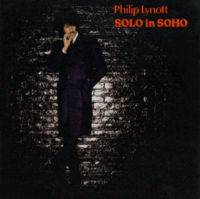
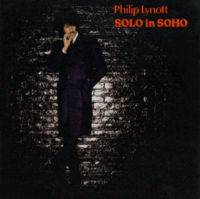 Philip Lynott : Solo in Soho
Philip Lynott : Solo in Soho











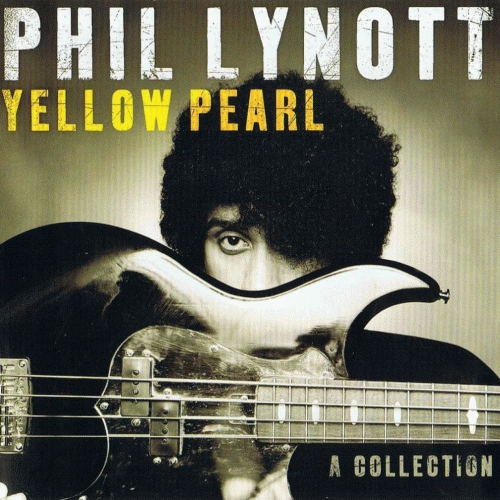
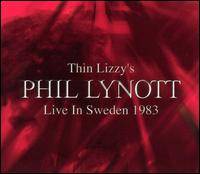

J'avais lu son bouquin "My Boy - The Phil Lynott Story" il y a une quinzaine d'années, que je ne peux que recommander.
Tu rends hommage à mes deux idoles, Phil et Lemmy.
Je ne dirais jamais un mot de travers sur Lynott et je ne donnerais donc pas mon avis sur ce disque "étonnant".
Sinon, aprés avoir placé le mot "cathédrale" dans plusieurs chroniques, tu sembles relever un nouveau défi : placer "Guyana" (cf. Agent Steel). Ca va être plus difficile!
Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire