Une simple mélodie. Répétitive. Aliénante. Annihilatrice. Abyssale.
Basée sur une uniformité forcément difficile d’accès, et une approche hypnotique de l’émotion, Clint Mansell a touché quelque chose de très spécial pour sa seconde bande originale, celle du merveilleux et culte
Requiem for a Dream, dans lequel le traumatisant Jared
Leto y trouva ses lettres de noblesses en tant qu’acteur et interprète d’exception.
Loin de la grandeur d’un Jerry Goldsmith, de la décadence d’un Hans Zimmer ou de la magie d’un Danny Elfman, Clint Mansell est allé puiser dans une musique plus introspective, décharné et minimaliste, intégrant une dose non négligeable d’électronique dans ses partitions, afin de renforcer l’aliénation vécue par les personnages, ainsi que leur isolement, symbolisé par une mélodie crue, distinctive, fleuve de cette BO de plus de cinquante minutes.
S’inspirant ouvertement (de ses mots) des travaux de Trent Reznor (
Nine Inch Nails), Clint Mansell a su donner une âme supplémentaire au film, un cœur encore plus poignant, et composer une œuvre à part entière, ode au désespoir humain, à ses addictions et ses finalités tragiques.
S’articulant autour de trois thèmes principaux ("Summer" / "
Fall" / "
Winter"), cette bande originale, interprétée en grande partie par le célèbre
Kronos Quartet, s’ouvre sur ce qui sera l’architecture musicale de cette longue litanie aux affres de la drogue. Une mélodie poignante, languissante, sinistre, ponctué par des relents électroniques, sortes de râles malsains et annonciateurs de la noirceur à venir, à l’instar de démons intérieurs prenant doucement mais surement le contrôle de notre esprit. Le violon, prédominant, installe un climat sombre et lourd, emplie de tension, tout en gardant une profonde accroche, presque addictif justement.
Le sentiment de vide à l’écoute de "Coney
Island Dreaming", égal au battement régulier d’un palpitant, mais avec toujours en toile de fond un sentiment grésillant de malaise, que les écarts électroniques de Party rendent encore plus malsains. Car l’électronique ici apporte réellement ce sentiment d’enfermement, de folie, de démence schizophrénique ("High on
Life") en réponse à l’impression perpétuelle de chute des arrangements classiques. Cette sensation de plonger dans un grand trou noir, et de ne pouvoir ni vouloir en sortir, presque en aimant ce malheur qui nous submerge et nous broie, petit à petit.
"Summer" s’articule autour du vide et de la mélancolie, de l’introspection notamment ("Dreams", "
Ten"), avec quelques écarts plus ou moins décadent ("
Ghost" et ses violons grandiloquents).
"
Fall", avec "Cleaning Apartment", débute d’une manière apparemment similaire, mais le plus grand nombre de pistes et de mélodies s’enchevêtrant dévoile une plus grande profondeur, comme une évolution dans la tension dramatique de la musique, la mélodie de violon s’accouple au vide provoqué par le piano, créant un amalgame de sentiments paradoxaux chez l’auditeur. On sent que le thème principal reste fondamentalement le même, les similitudes sont grandes, et les changements très discrets, mais présents, et c’est justement toute la justesse de l’œuvre, savoir créer un paysage sonore de plus en plus angoissant avec le temps, grâce à d’infimes changements de rythmes, ou apparitions de nouvelles partitions. Le phénoménal "Marion Barfs" mixant presque l’intégralité de ce qui fut écouté avant, presque comme un point d’ancrage, un constat à mis parcours de l’horreur à venir, toujours plus insoutenable. Arrive alors "Supermarket Sweep", étrange, déstructuré, évoquant le lointain Party mais en plus saccadé, plus rapide et organique, les tripes se serrant irréversiblement et de plus en plus fortement, devant cette musique des plus simples et binaires, mais étonnamment expressive.
Quand aux écarts groovy, divinement dérangeant, de "Bugs Got a Devilish Grin Conga" (représentant la démence de la mère du personnage principal), ils n’en sont que plus grinçants lorsque l’on débute "
Winter", notamment "Southern Hospitlity", plus ambitieux, grandiloquent et menaçant.
Montant en intensité tout au long des dernières pistes, le paroxysme de cette bande originale sera atteinte sur les épilogues "
Meltdown" et le culte "
Lux Aeterna". Le premier sonne l’heure du bilan, l’aspect aliénant ne pouvant aller plus loin, les images, identiques et hypnotiques, tournant inlassablement dans nos têtes, que ce soit cette mélodie toujours présente, ou les soubresauts de contrebasse, apportant noirceur et tranchant. Tout monte, de plus en plus lourd, malgré une musicalité toujours foncièrement minimaliste et peu grandiose (on est loin des arrangements à 200 pistes d’un Hans Zimmer). Quand à "
Lux Aeterna", la fin approche, on le sent, le sait, le malheur est passé, inéluctable, plus rien ne sera jamais comme avant. Un sentiment de mélancolie parcours la mélodie quelque peu plus lente et disgracieuse, évoquant des choix ayant pu être faits, et des vies à jamais balayées et littéralement détruites.
La musique s’arrête, les tremblements se stoppent, les tripes se desserrent un peu, mais le malaise reste là, profond, ancré en nous…pour longtemps…probablement comme un avertissement, de ce qui ne devra jamais arriver.

 BO : Requiem for a Dream
BO : Requiem for a Dream












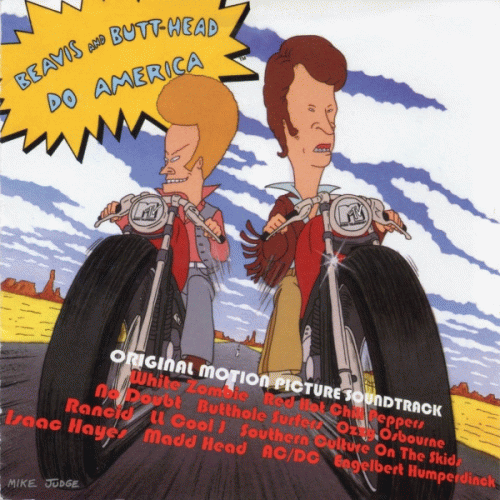

Je ne comprends pas trop ce que cela fait sur SoM mais c'est sympa :).
Merci pour ton comm Tiphany ;)
Par contre j'arrive pas à comprendre comment ce truc est arrivé sur SoM, sérieusement. N'y a-t-il pas une erreur quelque part?
Pour la grandiloquence je suis tout à fait d'accord, partir d'une BO terrifiante dans son minimalisme et sa pression pour en faire quelque chose de grandiose n'a juste aucun sens...si ce n'est d'impression les oreilles...
Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire